La séquestration carbone, un processus climatique essentiel ?
Un axe majeur de régulation du climat
Les Gaz à Effet de Serre, ou GES, sont présents dans l’atmosphère terrestre et interceptent les infrarouges émis par le sol après réception du rayonnement solaire. Ils agissent comme une serre naturelle qui permet de conserver assez de chaleur sur Terre pour y vivre. Les deux principaux gaz responsables de l‘effet de serre sont la vapeur d’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2).
Toutefois, l’augmentation de certains de ces gaz provoquée par les activités humaines conduit au réchauffement global du climat. Depuis le début de l’ère industrielle, c’est à dire depuis l’année 1750 environ, l’homme a provoqué une augmentation de la chaleur retenue par la planète équivalent à 1% du rayonnement solaire1. À elles seule, les émissions de CO2 d’origine anthropique sont responsables d’un peu moins de 65% de l’effet de serre additionnel1. Elles proviennent pour l’essentiel de la combustion des énergies fossiles et du phénomène de déforestation, en zone tropicale, qui libère le carbone stocké dans la biomasse des forêts sous forme de CO2. En raison de la responsabilité non négligeable du CO2 dans le réchauffement climatique, les efforts de réduction et de séquestration se concentrent principalement sur le « carbone ».
La séquestration carbone est un procédé qui vise le stockage durable de carbone hors de l’atmosphère, dans des réservoirs adaptés. La séquestration a donc un effet direct sur la régulation du climat. C’est pourquoi elle constitue un axe majeur de mise en œuvre de l'Accord de Paris, qui vise à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5°C.
Le socle du concept de neutralité planétaire
Le premier jalon temporel de l’Accord de Paris (article 4) est l’atteinte de la neutralité carbone planétaire au cours de la seconde moitié du XXIe siècle. Cet objectif nécessite d’arriver à un équilibre entre les émissions anthropiques de GES et leur absorption, ou séquestration, par les réservoirs planétaires. La séquestration carbone constitue donc l’un des deux procédés essentiels pour aboutir au point de neutralité, avec la réduction des émissions. Étant donné l’urgence climatique, il est aujourd’hui devenu impératif d’agir sur les deux côtés de la balance en parallèle.
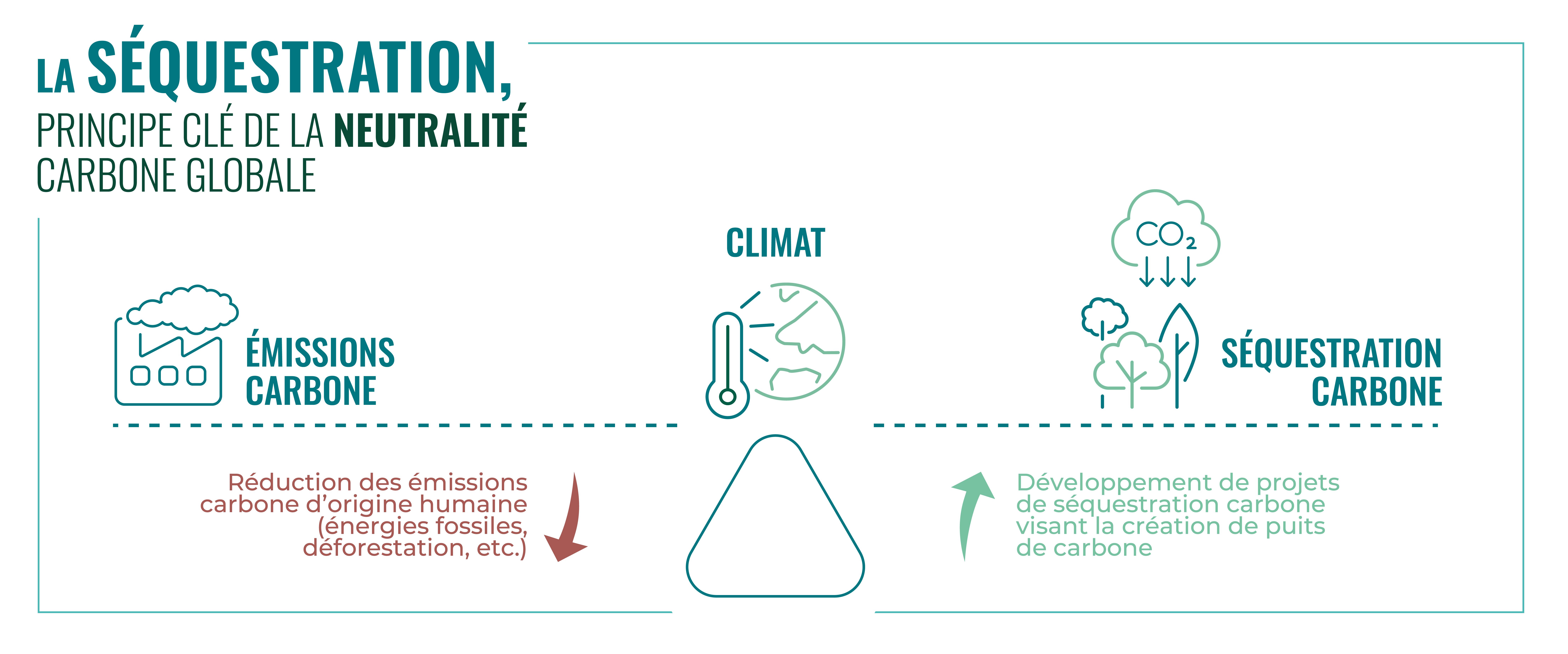
Les puits de carbone terrestres
La séquestration s’inscrit dans le cycle naturel du carbone qui décrit l’ensemble des réactions biochimiques engageant cet élément chimique dans la nature. Le captage naturel du carbone est rendu possible grâce à différents procédés impliquant la matière organique et minérale. Parmi eux, on peut citer la photosynthèse des végétaux qui permet de stocker le CO2 atmosphérique au sein de la biomasse, ou encore la décomposition de matière organique dans les sols.
Un puits de carbone est un réservoir qui capte le carbone atmosphérique et le stocke à long terme et en grande quantité. Les projets de séquestration ont donc comme principe de base le développement de puits de carbone. Il peut s’agir de réservoirs naturels, dits biologiques, ou artificiels, c’est-à-dire issus de l’ingénierie humaine. Les principaux réservoirs terrestres naturellement présents dans la nature sont :
Les océans, qui constituent le puits de carbone le plus important grâce à la dissolution du CO2 dans l’eau de mer et l'activité du phytoplancton ;
Les forêts, qui stockent le carbone dans la biomasse (bois, racines) via le processus de photosynthèse réalisé par les végétaux, ainsi que dans le sol forestier ;
Les sols, qui stockent une grande quantité de carbone sous forme de matière organique ou de matériaux carbonatés ;
D’autres écosystèmes naturels tels que les tourbières, les marais ou les prairies, qui stockent du carbone dans les végétaux qu’ils contiennent, ainsi que dans le sol.
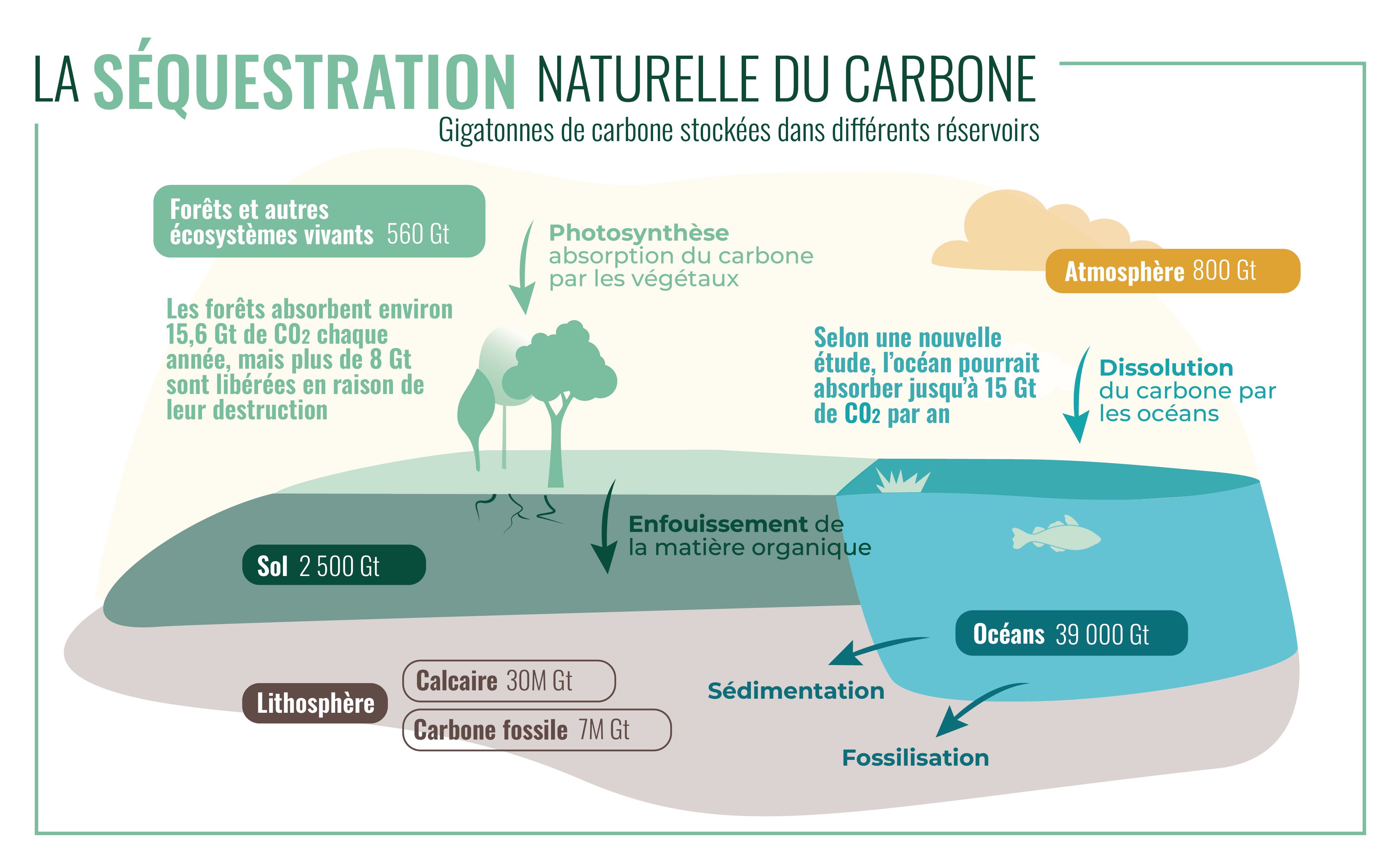
En quoi consiste un projet de séquestration carbone ?
Séquestration et évitement : quelle différence ?
Les projets de séquestration et les projets d'évitement représentent deux approches distinctes pour lutter contre le changement climatique, chacune jouant un rôle important mais différent.
Séquestration : les projets de séquestration impliquent la capture et le stockage à long terme du CO2 déjà présent dans l'atmosphère. Ils peuvent être basés sur des procédés naturels, connus sous le nom de Solutions fondées sur la Nature (NbS), ou sur des systèmes de captage du carbone artificiels. Le cycle du carbone étant un processus s’inscrivant dans la durée, les résultats des projets de séquestration ne sont visibles qu’à long terme.
Évitement ou réduction : ces projets consistent à diminuer les émissions de CO2 par l'adoption de technologies et de pratiques plus propres et plus efficaces. Cela peut concerner l'amélioration de l'efficacité énergétique ou industrielle, les énergies renouvelables, l’adoption de pratiques agricoles durables, l’économie circulaire, etc. La viabilité de tels projets est fondée sur un scénario de référence contrefactuel (baseline) qui permet de prouver qu’il y a bien eu réduction ou évitement par rapport à une situation initiale. Les effets des projets d’évitement sont immédiats, car ils concernent des émissions qui auraient eu lieu à court termes.
Les Solutions fondées sur la Nature (SfN)
Les projets de création de puits de carbone naturels apparaissent aujourd’hui comme la façon la plus efficace et la plus sure de retirer et stocker durablement le carbone de l'atmosphère. De plus, les écosystèmes fournissent bien d’autres services, notamment pour la biodiversité et le bien-être humain. Ceci constitue un argument en faveur du développement de projets de restauration des espaces naturels, qui peuvent être de différentes nature :
Les projets de reforestation et d’afforestation visent à créer ou restaurer des écosystèmes forestiers, que ce soit sur des terres récemment déboisées ou depuis longtemps dégradées. La gestion améliorée des forêts exploitées commercialement permet également l'augmentation des stocks de carbone. Les forêts mondiales absorbent environ 15,6 gigatonnes de CO2 chaque année, ce qui représente trois fois les émissions annuelles des États-Unis2.
Les projets de restauration des zones humides, ou de carbone bleu, visent la capture et la séquestration du carbone dans les écosystèmes aquatiques et côtiers, tels que les herbiers marins et les mangroves. Bien qu'elles n'occupent que 5 à 8 % de la surface terrestre, ces zones renferment entre 20 et 30 % de l'ensemble du carbone organique du sol3.
Les projets de gestion améliorée des terres agricoles se concentrent sur le renforcement du stockage du carbone dans les sols cultivés grâce à une transition vers des pratiques plus durables et régénératrices.
Les projets d’agroforesterie visent à intégrer des arbres et des arbustes dans les zones de culture et d'élevage et permettent ainsi d’améliorer le captage du carbone à la fois dans les éléments ligneux et dans les sols.
Les solutions technologiques de stockage du carbone
Les NbS sont actuellement les solutions plus efficaces et les mieux maîtrisés pour séquestrer le carbone à grande échelle. Cependant, elles présentent des risques liés à la complexité des processus naturels. C’est pourquoi des alternatives technologiques de captage du CO2 sont en cours de développement et pourraient jouer un rôle important à l'avenir dans la lutte contre le changement climatique :
La capture directe de l’air (DAC) : la méthode de Direct Air Capture (DAC) vise à capter le CO2 dans l'air ambiant par des filtres - via des procédés chimiques ou physiques - souvent directement là où il est rejeté, soit à proximité des sites industriels. Une fois capturé, le CO2 doit encore être stocké durablement grâce à d’autres processus artificiels. La technologie DAC est encore peu mature et fait face à des défis techniques et économiques.
La capture, la valorisation et le stockage du carbone (CCUS) : l’acronyme Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) correspond à un ensemble de technologies permettant de capturer, transporter et injecter le CO2 dans des réservoirs souterrains, tels que des formations géologiques ou d’anciens gisements de pétrole et de gaz. Cette technique vise également l’utilisation du carbone comme ressources pour la fabrication de produits de valeur comme le méthanol.
Les projets de séquestration, une solution pour les entreprises ?
Aujourd’hui, plusieurs obligations et tendances réglementaires incitent les entreprises à réduire drastiquement leurs émissions. Dans le cadre du marché réglementaire européen, ou Système d'Échange de Quotas d'Émission (SEQE), les entreprises des secteurs de l'énergie, de l'industrie et de l'aviation doivent se conformer à des quotas d'émissions de CO2. En parallèle, le reporting extra-financier est renforcé en Europe au travers de la mise en place de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Toute entreprise de plus de 250 salariés doit faire son bilan carbone et fournir des informations détaillées sur sa politique climatique.
L’objectif Net Zéro de la SBTi
Un nombre croissant d'entreprises s'engage sur des objectifs de réduction de leurs émissions de GES validés par la Science Based Targets initiative. L'objectif Net Zero de la SBTi est une initiative lancée en 2021 pour aider les entreprises à atteindre le « zéro émission nette », grâce à une méthodologie crédible et basée sur des données scientifiques. Dans ce cadre, une entreprise s’engage à réduire ses émissions de GES de 90 à 95% avant 2050.
La compensation carbone volontaire
En parallèle des actions menées dans leur chaîne de valeur pour réduire au maximum leurs émissions, les entreprises sont encouragées à investir dans des projets en dehors de leur chaîne de production. Un projet de séquestration certifié par un standard international génère des « crédits carbone » qui peuvent être achetés par une entreprise dans une démarche volontaire : c’est ce qu’on appelle la « compensation carbone » ou « contribution carbone ». Dans ce domaine, la tendance est cependant à la transparence et à l'authenticité pour maintenir la crédibilité des entreprises et des crédits sur le marché, et ainsi éviter toute forme de greenwashing.
Parce que les forêts jouent un rôle majeur dans l’absorption du CO2, les projets de restauration des écosystèmes forestiers sont des actions vitales pour l’adaptation aux changements climatiques actuels et leur atténuation sur le long terme. Retrouvez notre solution d’investissement dans des projets forestiers certifiés pour anticiper dès maintenant la stratégie climat de votre entreprise et créer de la valeur à long terme.
Vous souhaitez échanger avec nos experts ? C’est par ici !
1 Quels sont les gaz à effet de serre ? Jean-Marc Jancovici, 2007 2 Source : NASA 3 Source : IPCC